Dans le premier épisode de mon analyse de Shadow of the Colossus, j’ai pris le temps de poser le décor avec un soin particulier. J’ai souhaité faire revivre dans vos esprits le prologue de ce titre intemporel, qui n’a de cesse d’être remasterisé et de ressortir sur toutes les générations de consoles Playstation. Un titre inoubliable, dont nous n’avons fait qu’effleurer le gigantisme au travers de ce que nous raconte ses environnements, sans même toucher du doigt les imposants colosses, pourtant au coeur de cette oeuvre à nulle autre pareille. Le temps du vertige est venu. Affrontons ensemble ces géants énigmatiques qui gardent les Terres Interdites.
Colosses aux pieds d’argile
La boucle de gameplay fondamentale de Shadow of The Colossus réside dans ses affrontements avec des créatures gigantesques. Amalgames arcaniques de terre, de mousse, de roche, de poils et de plumes ; ils incarnent par leur simple aspect physique l’Alpha et l’Oméga de leur environnement. Plus qu’adaptés, ils sont forgés et fondus dans le monde qui les entoure, à l’image des furtifs de Damasio que l’on aurait ralentis à l’extrême et rendus vulnérables. Conçus comme des gardiens, placés astucieusement aux quatre coins de la vallée, dans des régions jugées inaccessibles au commun des mortels, ils protègent de leur vie le sceau qui condamne la porte vers l’ultime colosse. Chacun d’eux peut ainsi être envisagé comme le fragment d’une clé titanesque permettant de déverrouiller l’accès vers le réel artefact dont les Terres Interdites ne sont que l’écrin. Seizième colosse dont l’existence même se résume à être le verrou du démon Dormin, enfermé depuis des siècles en ces lieux chargés de mystères.
Défaire ces créatures magistrales, et bien souvent majestueuses, demande un soupçon d’ingéniosité. Il vous faudra à chaque fois comprendre par où commencer, par quelle voie grimper, trouver l’emplacement des runes cachées dans l’épaisse fourrure, et, ce qui n’est pas toujours le plus évident en raison de la physique capricieuse du jeu, frapper ces points vitaux de votre épée jusqu’à l’anéantissement du colosse pourchassé. Un air mélancolique se joue alors, où se mêlent des voix spectrales dans un chant liturgique. La créature s’effondre, lentement, s’étalant horriblement sur son lit mortuaire. De ses plaies jaillissent des tentacules obscurs, auxquels Wander ne pourrait échapper même en fuyant à l’autre bout du monde. Telles des érinyes assoiffées de vengeance, elles finissent toujours par le frapper en plein cœur pour s’y lover et pour y disparaître…
Quiconque a déjà joué à Shadow of The Colossus aura été marqué par ces scènes victorieuses douces-amères. De par ses productions, l’industrie du jeu vidéo nous a peu à peu habitués à une grammaire au centre de laquelle la figure du héros a une place prédominante. Présenté comme un défenseur du bien, nous l’incarnons dans son combat contre les forces du mal et nous n’hésitons pas à tuer ce que nous considérons sans en douter comme des ennemis de l’ordre moral et du monde civilisé. Nous sommes devenus, par habitude, le bras vengeur d’une idéologie qui nous dépasse, mais que l’on choisit de suivre quand même. Ce que fait Shadow of The Colossus, avec une si grande justesse qu’il ne peut s’effacer des mémoires, c’est justement questionner les agissements de son joueur. Mieux encore, les juger dans toute leur dimension horrifique. Celle de suivre aveuglément une quête délétère en répandant mort et désolation sur son passage. Celle de faire couler le sang de créatures innocentes et pacifiques, qui jamais ne vous frapperont sans raison, et qui pour la plupart ne chercheront qu’à vous chasser de leur repaire.
Les piques au cœur
Jouer à Shadow of The Colossus, c’est en un sens se confronter à la noirceur qui est en soi et l’accepter pas à pas. Accepter de plonger volontairement dans l’abject et la frénésie violente. Car si le joueur peut plaider l’innocence lorsqu’il affronte le premier colosse, il devient on ne peut plus clair lors de sa mort que l’acte qui a été perpétré était gratuit et barbare. A chaque coup reçu, le géant laisse échapper un râle d’agonie strident qui nous parcoure l’échine. Il ne se défend pas, tente même de fuir comme il le peut, s’enferme dans un cul de sac et nous repousse du dos de la main avec force soubresauts et ruades. Le spectacle est affligeant mais ne cessera pas, car nous sommes bien trop rodés à l’exercice, parce que le média a ses propres codes auxquels il ne déroge que très rarement. Parce qu’en un sens, lorsque je lance ce jeu pour la première fois sur ma PS2 en 2006, Shadow of The Colossus est la toute première œuvre qui m’interroge sur la moralité de mes actes virtuels.
Si ce premier sang versé émeut le joueur, lui fait ressentir par un travail de scénographie minutieux tout le poids de la gravité de son acte, il n’est que le tout premier d’une longue série. Peu de joueurs, sinon aucun, n’éteignent la console à ce moment-là. Parce que Shadow of The Colossus se vit comme une tragédie dont nous sommes le héros. Une tragédie dont nous pressentons la destinée malheureuse, mais dont nous ne pouvons nous détourner par fatalité. Cette noirceur qui emplit l’âme de Wander, qui nous rend honteux à chaque victoire est à mon sens une jolie façon d’incarner l’Oreste meurtrier de la mythologie grecque. De ressentir la transe absurde, la fuite en avant, la main assassine. Nous partageons le fardeau de Wander, et nous l’accompagnerons jusqu’au bout de son projet sordide en portant à ses côtés une part de sa culpabilité, de sa démence et de sa perdition.
Plus l’aventure avance, plus Wander se déshumanise. Le beau jeune homme au visage pâle perd ses atours sous l’influence de la corruption qui l’imprègne désormais. Sa peau se craquelle et laisse apparaître un veinage sombre qui ne le quittera plus. Petit à petit, il devient le vaisseau de l’engeance démoniaque qui guide ses pas. Déformé par la haine, avili par le poids de toutes ces âmes violemment arrachées, Wander offre une place grandissante à l’esprit de Dormin. Au paroxysme de sa descente aux enfers, deux cornes percent son crâne et ses yeux prennent une teinte surnaturelle. Lié à Wander par le destin, par le sens imposé du jeu, le joueur perd ses illusions et son empathie pour les colosses en chemin à force de combats. La mort qui nous choquait et nous révulsait auparavant se mue en indifférence, en fureur, puis en ivresse, dans notre quête de toute-puissance.
L’épique au cœur
Tout cruel et effroyable qu’il puisse être, Shadow of the Colossus souffle un vent épique auquel il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de résister. De son ancrage profond dans les thèmes bibliques et mythologiques nait une universalité qui nous emporte naturellement. Wander incarne à lui seul une infinité de personnages fantasmés auxquels nous nous raccrochons parce qu’ils disent l’humanité dans ce qu’elle a de plus primitif. Orphée, Oreste, Ulysse, Icare, Nimrod, Lucifer et bien sûr David. Wander a cent visages qu’il nous plaît d’endosser de manière conscience ou non. Il est l’anti-héros du monomythe de Joseph Campbell que nous nous plaisons à voir tomber encore et encore face à son hybris exacerbé. Nous sommes prêts pour cela à planter le glaive profondément dans la chair, à le faire ad nauseam en multipliant les parties dans un mode new game + qui ne dit pas son nom. Pour peu que la musique nous accompagne, pour peu que nous finissions par toucher au sublime.
Car il serait illusoire de penser que les crédits de fin de jeu sont une réelle conclusion au titre. Une fois les seize colosses défaits et l’histoire de Wander achevée, nous serions en droit de penser que l’aventure est terminée, que le jeu peut être rangé dans sa boîte avec le sentiment d’avoir vécu quelque chose de fort et d’impactant. Ce serait là une terrible méprise. En effet, cette première partie n’est que le début de la réelle épopée qu’il vous faudra mener pour venir à bout du dernier et du premier colosse du jeu : le Sanctuaire en lui-même. Comme je l’évoquais rapidement dans la première partie de ce dossier, ce lieu central des Terres Interdites recèle bien des mystères. Et à l’instar des autres colosses du jeu, il est possible de l’escalader pour parvenir à son sommet. Un lieu caché, jugé si haut qu’il vous semblera inhumain d’y arriver, et pourtant…
Pourtant, vous pourrez bel et bien y accéder en recommençant le jeu dans son intégralité sept fois au minimum ! La jauge d’endurance continuera à grandir après chaque colosse vaincu, prenant bientôt jusqu’à un quart de l’espace à l’écran. Au terme de cet exploit, qui vous accordera des dons quasi divins, vous serez tout juste en mesure de grimper la tour dans son immensité pour rejoindre un lieu sacré et irréel. Cela vous donnant accès par la même occasion à ce pont interminable qui vous toisait depuis plusieurs dizaines d’heures. A cet instant, Shadow of The Colossus parachève par son game design le message qu’il cherchait à transmettre tout en saluant d’une révérence son héritage antique.
Shadow of the Colossus touche à quelque chose de profond et d’universel : une réflexion sur la quête de puissance, l’obsession aveugle et la fatalité d’un destin que l’on a soi-même embrassé. À travers ses affrontements monumentaux, ses silences pesants et son atmosphère d’épopée tragique, il nous confronte à nos propres contradictions. Ce que l’on croyait être une aventure héroïque s’efface progressivement pour révéler un cycle destructeur, où chaque victoire est une perte, un pas de plus vers l’abîme. Et pourtant, nous persistons, poussés par un mélange d’admiration et d’obsession, qui malgré tout, fait éclater quelque chose de sublime, une beauté terrible que l’on accepte d’affronter tout en sachant qu’elle nous laissera à jamais marqués. Shadow of the Colossus n’est pas un jeu que l’on termine. C’est un jeu qui nous hante.
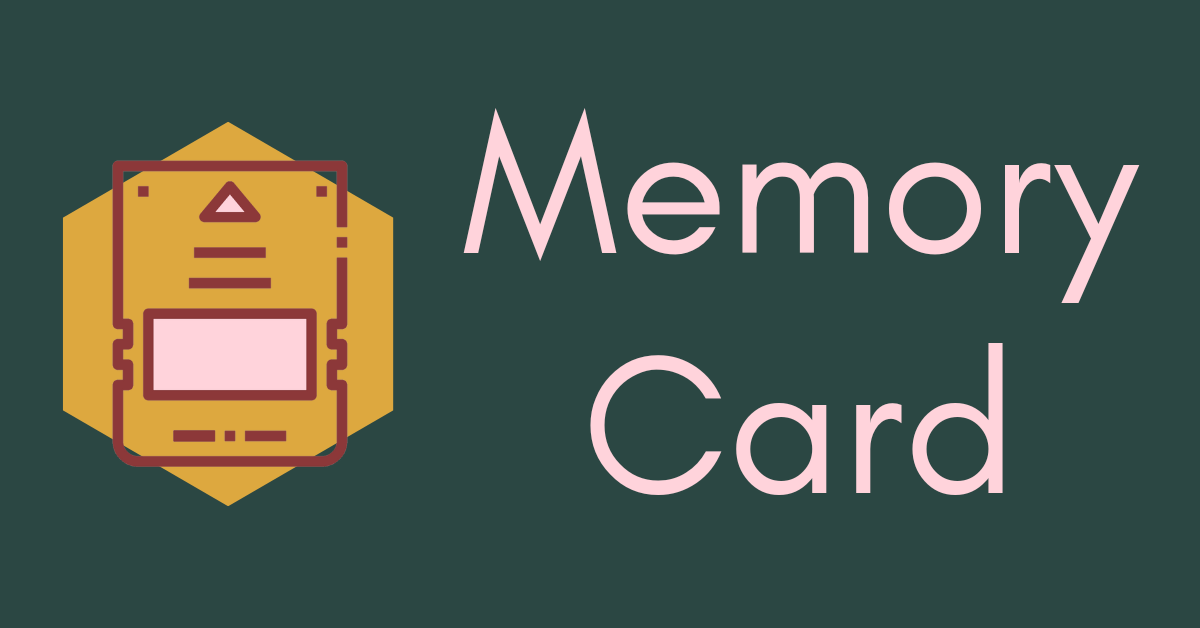
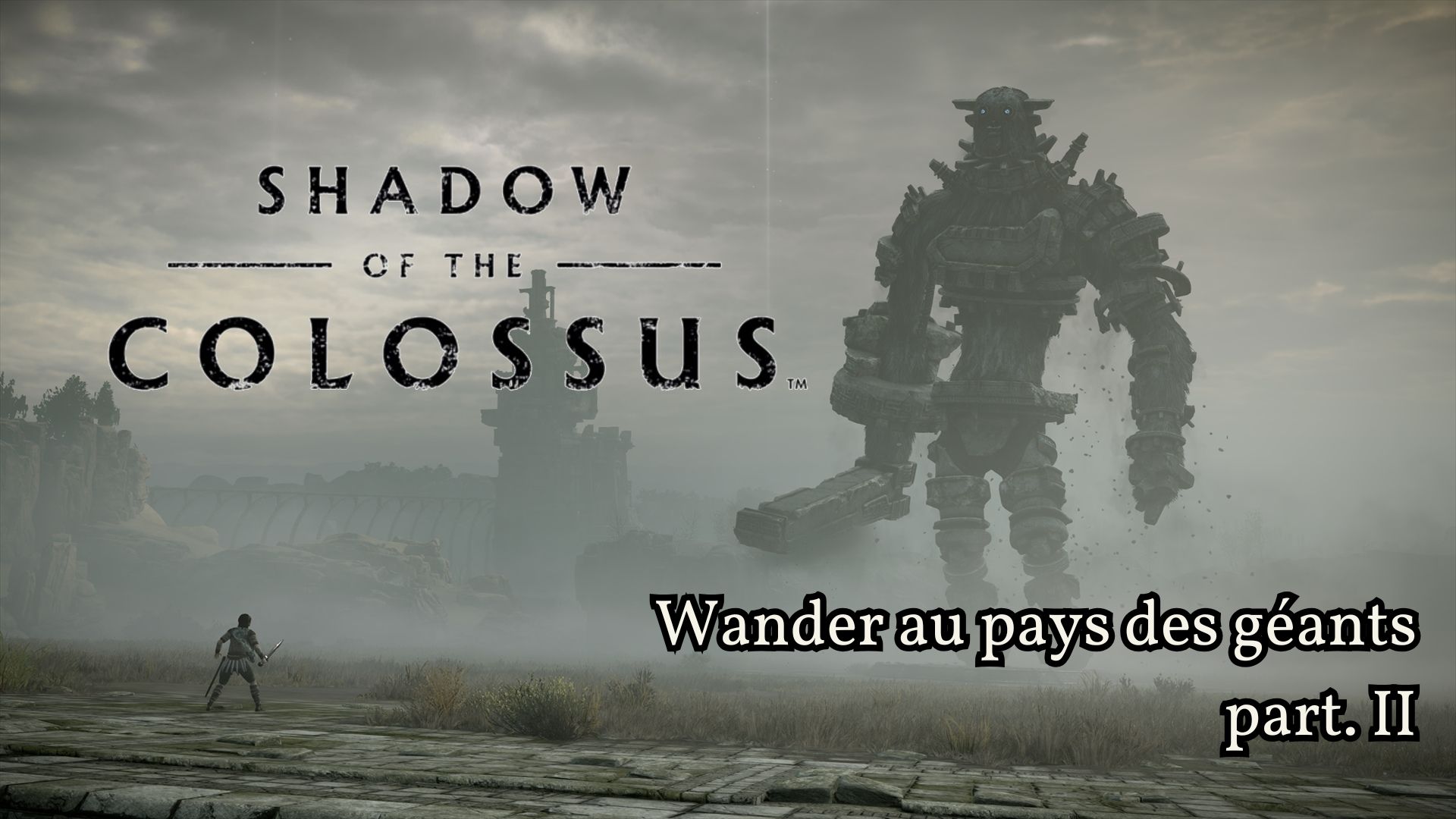
Laisser un commentaire